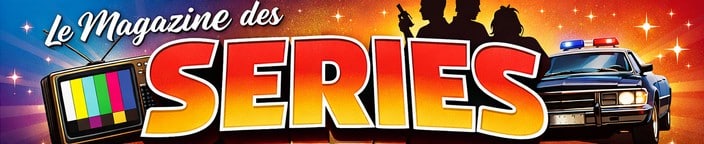Par Thierry Le Peut
Un inconnu vous aborde dans la rue et votre vie bascule du jour au lendemain de la platitude à l'aventure. L'amour, bien sûr, est au bout du chemin. Partant d'un cliché éternel (l'effet Impulse, aussi brutal que l'effet Kiss Cool), "Les Deux font la paire" parvient pourtant à développer un univers qui lui est propre. Ainsi, la série récupère les vieux poncifs pour en faire sa matière première, en les dépoussiérant au passage. Guerre des sexes et lutte des blocs, la série "Les Deux font la paire" est donc un mélange réussi d'espionnage et de comédie romantique. Bref, un programme que l'on ne revoit pas assez sur nos écrans pour ne pas dire plus du tout !

INTRODUCTION
Quand ils créent "Les Deux font la paire" en 1983, Brad Buckner et Eugenie Ross-Leming ne sont pas à proprement parler des stars. En revanche, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années. En effet, ils ont produit et écrit ensemble deux courtes séries inédites chez nous. Tout d'abord, "Forever Fernwood" en 1977/1978. Ensuite, "Highcliffe Manor" en 1979.
Orson Bean, le futur Loren Bray de "Docteur Quinn femme médecin", était le Révérend Brim dans la première. Il donnait ainsi la réplique à Dabney Coleman (Buffalo Bill), Richard Hatch ("Les Rues de San Francisco" dernière saison et surtout "Galactica" où il fut Apollo) ou encore Joe Penny (Nick Ryder dans "Riptide"). La seconde, qui ne compte que quatre épisodes, était une comédie extravagante. En effet, une équipe de scientifiques excentriques occupait un vieux manoir de la Nouvelle-Angleterre.
Excentrique ? Extravagant ? Ross-Leming et Buckner fourbissaient sans doute leurs armes pour produire une idée plus accessible au grand public. En résumé, l'alliance improbable d'une ménagère et d'un espion, du bon sens pragmatique et de l'aventure, de la réalité la plus prosaïque et du romanesque le plus échevelé.
LA CREATION DE LA SERIE
C'est d'abord ce mélange qui séduit dans "Les Deux font la paire". Mais qui séduisit aussi l'actrice Kate Jackson, qui depuis les "Drôles de Dames" n'avait tourné que quelques téléfilms sans retrouver de personnage aussi charismatique que celui de Sabrina Duncan dans la série d'Aaron Spelling.
A l'époque où elle est devient Amanda King, Kate Jackson est mariée au producteur David Greenwald, après avoir divorcé d'Andrew Stevens (Casey Denault dans "Dallas" et Glenn Matthews dans "Scandales à l'Amirauté"). Elle dirige sa propre maison de production baptisée Shoot The Moon Enterprises. En qualité de productrice, elle aura donc son mot à dire sur les scénarii de la série, bien plus que son partenaire Bruce Boxleitner, par ailleurs moins bien payé qu'elle.
En 1983, Boxleitner vient juste d'interpréter Frank Buck dans la série "Frank, chasseur de fauves", qui n'aura vécu que dix-sept épisodes. Quelques années plus tôt, il s'était fait connaître en incarnant Luke Macahan dans la série-feuilleton western "La Conquête de l'Ouest", sur laquelle il avait connu sa femme Kathryn Holcomb.
Père d'un petit Sam Clifford, né en 1981 (et plus tard d'un deuxième enfant, Lee Davis, né en 1985), il donne avec Kitty l'image d'un couple heureux et comblé. Une situation enviée que "Les Deux font la paire" mettra à mal. Il est vrai que Kitty supportait mal la présence de Kate Jackson auprès de son mari. De surcroît, elle vivait semble-t-il assez mal également le fait d'avoir abandonné sa propre carrière pour se consacrer à son mariage. En 1987, alors que la série s'arrête au bout de quatre saisons, Boxleitner perd aussi sa famille et cette image de bonheur parfait. C'est plus tard avec Melissa Gilbert, immortelle Laura de "La Petite maison dans la prairie", elle aussi blessée par un mariage raté avec Rob Lowe, que l'acteur retrouvera le sourire et le bonheur.

TOUT SAUF REALISTE
Bref, en 1983 tout semble aller pour le mieux. La série imaginée par Buckner et Ross-Leming commence sous de bons auspices. Diffusée sur CBS à partir de septembre, elle impose très vite un esprit savoureux. Celui-ci est fondé sur le contraste entre les héros. Mais aussi sur l'accumulation des situations les plus rocambolesques. Car "Les Deux font la paire" n'est pas une série réaliste.
Douce Amanda
Ainsi, on pourrait penser le contraire en découvrant la jeune mère divorcée Amanda King dans son home douillet. Nous sommes au coeur d'une maison typiquement américaine, préfabriquée et posée au milieu d'un quartier résidentiel. Le tout avec façade blanche, pelouse artificielle et petite allée pour garer la voiture. Couchée devant un feu confortable avec son fiancé Dean, que l'on entreverra deux fois dans la première saison, Amanda incarne le romantisme à deux sous d'une jeune femme totalement impliquée dans une vie de famille parfaitement réglée.
Divorcée du père de ses deux enfants et installée chez sa mère, elle porte des ensembles très simples. Elle ne connaît de véritable évasion qu'à travers les livres d'aventures et les visites de son fiancé. Même sa voiture, un break, est à l'image d'une Amérique familiale. Celle partagée entre les courses, le repassage et l'éducation de deux gamins à peine plus turbulents que la moyenne des bambins de l'Oncle Sam. Rien de surprenant, rien de révolutionnaire, rien de compliqué.
Tout bascule...
Comment Amanda King se douterait-elle que le simple fait d'accompagner son petit ami à la gare va en un instant faire basculer sa vie dans un monde insoupçonné où ses repères n'auront plus cours ? Si dans la publicité un inconnu peut brusquement vous offrir des fleurs et conquérir votre coeur, celui qui aborde Amanda sur le quai n'a rien, a priori, du prince charmant attendu. Habillé en serveur, plus cavalier que chevaleresque, il bouscule la jeune femme plus qu'il ne l'aborde. Puis, il lui fourre entre les mains une boîte mystérieuse. Enfin, il disparait sans explication en la laissant interloquée et bien embarrassée.

IL ETAIT UNE FOIS...
La rencontre déconcertante, placée d'emblée sous le signe de l'incompréhension et de l'opposition, est inhérente au cliché. Etant donné le concept de la série (le duo homme-femme), inutile d'être un grand sorcier pour comprendre immédiatement que ces deux-là sont appelés à se rapprocher à plus ou moins long terme.
Un drôle de pacte
Mais l'affaire n'est pas gagnée. En effet, visiblement, le bonhomme (on apprendra qu'il s'appelle Lee Stetson et que c'est un espion surnommé « Scarecrow » (l'Epouvantail) passe sa vie à sauver le monde en se battant contre de méchants espions de puissances ennemies, soviétiques ou est-allemands en particulier. Il ne s'intéresse donc qu'à sa boîte. Ainsi, Stetson considère la participation d'Amanda comme un accident. En somme, une contingence dictée par la Nécessité. De fait, poursuivi par des tueurs patibulaires, il n'a guère pris le temps de choisir sa collaboratrice d'un instant ! Le problème, c'est que la transmission de la boîte va prendre, à la faveur des circonstances, une valeur d'acte magique, liant pour longtemps le destin de l'espion et de la ménagère.
Sommée de remettre l'objet à « l'homme au chapeau rouge », Amanda se trouve face à un train entier d'hommes coiffés de rouge. On pourrait se croire dans un conte peuplé de créatures bizarres. Une histoire faite d'enchaînements improbables. Mais pour l'heure Amanda est bien forcée de regagner sa réalité à elle avec la boîte mystérieuse qui a déjà transformé sa vie. Que l'événement coïncide avec le départ du fiancé, simple silhouette ayant servi à l'exposition du personnage mais trop inconsistante pour retenir la lumière, n'est évidemment pas un hasard. Son absence laisse la jeune femme face à elle-même. La voici brusquement sollicitée dans un état de disponibilité dont elle n'avait probablement même pas conscience.
Un talent insoupçonné
Comme dans le conte, toujours, l'événement modificateur va jouer le rôle de révélateur. Car en étudiant le contenu de la boîte magique la jeune femme va se découvrir des talents d'investigatrice et faire remonter du tréfonds de son être un don inné pour l'espionnage et un goût insoupçonné de l'aventure. Par des recoupements appropriés et un sens certain de l'initiative personnelle, elle parviendra même à sauver la mise aux espions professionnels et à déjouer les agissements crapuleux d'espions internationaux.
Un exploit en forme de baptême du feu qui sera renouvelé dans plusieurs épisodes, parfois de manière un peu répétitive mais avec suffisamment de conviction et d'imagination pour faire oublier les invraisemblances somme toute secondaires et de toute façon inhérentes à la série.

LE TEMPS DE L'INITIATION
La fin d'un long sommeil
"Les Deux font la paire" se présente donc comme une série classique d'initiation. Projetée par le hasard dans un univers qu'elle côtoyait sans le savoir, à mille lieues de son quotidien limpide et immédiat, l'héroïne apprendra au fil des épisodes à utiliser des qualités et à développer des potentialités que sa vie trop bien réglée laissait inexploitées. La Belle se réveille après un long sommeil, encore engoncée dans les haillons de Cendrillon et méprisée par ses soeurs mieux loties - en apparence. Ici, la soeur pénétrée de son importance est jouée par Francine, l'assistante du patron de Scarecrow, collaboratrice occasionnelle du bel espion.
Francine, la terrible
Comme dans le conte de Grimm, et déjà dans la vieille histoire d'Amour et Psyché, la soeur est plus jolie, mieux habillée et plus « classe » que l'héroïne aux habits de ménagère ordinaire. En revanche, elle n'est pas plus intelligente : droguée par les méchants, elle leur livre des informations confidentielles tout en cherchant vainement l'origine des fuites qui mettent en péril les services secrets de son pays. Mais c'est la timide Psyché qu'Amour a finalement choisie pour lui révéler les délices de l'Autre monde, et la méchante soeur est punie de sa sévérité. Bref, Francine regarde de haut la nouvelle venue dont elle rejette la vulgarité, mais lui devra en définitive son salut !
Un schéma efficace
Classique ? Certainement, mais bien enveloppé. Buckner et Ross-Leming, qui signent sept des premières histoires de la saison, ont su agréablement réutiliser les composantes du conte pour concevoir une adaptation moderne et originale. Le ton est vif, tant dans les dialogues que dans le déroulement de l'action : les événements s'enchaînent sans trop de longueurs, l'héroïne filant de découverte en découverte vers la résolution de l'énigme et la confrontation avec les méchants, en forme d'apothéose. Une dernière séquence, plus calme, assure la liaison avec la suite de la série en donnant à Amanda le statut d'agent auxiliaire, confirmant la réussite de la première épreuve, même si elle doit encore faire ses preuves.
Ce n'est qu'un an et quelques mois plus tard, dans l'épisode « Danger mannequin » (le trentième), qu'elle accèdera à une nouvelle épreuve décisive en passant les examens d'admission. Entretemps, vingt-huit aventures mouvementées auront permis à la ménagère de montrer l'étendue de ses capacités et de seconder efficacement Scarecrow dans sa lutte contre l'ennemi infatigable et polymorphe.
Drôle de conte
On apprécie, en découvrant le premier épisode, la façon dont les codes du conte sont agréablement détournés. L’intrigue de la boîte se nourrit d’une tradition que l’on trouve encore dans le "Mulholland Drive" de David Lynch (et dans "Twin Peaks", au demeurant). La découverte du contenu de la boîte (et donc de la clé de l’énigme) passe, en outre, par la transgression d’un interdit lorsque l’un des fils d’Amanda avoue avoir ouvert le paquet sans autorisation - paquet entretemps perdu puisque la mère de l’héroïne a eu la généreuse mais calamiteuse idée de la confier aux services postaux.
Par la suite, nombre de scénarii conserveront ces données culturelles, invoquant des princesses en détresse (« Retour aux sources ») et appelant sans cesse à la suspension du « principe de réalité ». L’épisode de Noël de la première saison, « Le réveillon le plus long », est significatif de cette belle inspiration : chargés d’empêcher un ancien espion de révéler des secrets d’Etat, Lee et Amanda passent la nuit de Noël dans une cabane perdue au fond des bois et réussissent l’exploit de réconcilier pour quelques heures des espions des deux bords ainsi que deux commandos armés envoyés pour liquider l’espion récalcitrant.
LA FENETRE DE LA CUISINE
Au fil des épisodes, un autre motif emprunté à la tradition romantique (Roméo et Juliette et les innombrables sérénades au clair de lune...) sera constamment repris avec un souci de décalage aussi astucieux que savoureux : la rencontre à la fenêtre de la bien-aimée (quand bien même celle-ci n’est pas reconnue comme telle).
C’est donc sous la fenêtre de... sa cuisine que Lee aura de fréquents entretiens avec Amanda, parfois sous le nez de l’innocente maman. Ailleurs, il empruntera encore la fenêtre pour s’introduire nuitamment dans ses appartements (dans « Retour aux sources ») ou pour lui remettre des informations confidentielles, poussant au besoin la conscience professionnelle jusqu’à l’embrasser pour tromper la vigilance des importuns (dans « Tactique de jeu »). Le titre même de la série "Les deux font la paire", "Scarecrow & Mrs King", met en avant l'aspect de conte voulu par Ross-Leming et Buckner. On pense à une rencontre insolite dans l'esprit du "Magicien d'Oz", d'"Alice au pays des merveilles", d'"Edward aux mains d'argent" ou encore de "L’aventure de Madame Muir".
Enfin, le thème musical composé par Arthur B. Rubinstein, lui, insiste sur le rythme alerte de la narration mais recourt à une ampleur symphonique qui s’accorde tout à fait à l’esprit du conte. Basé sur le mouvement, il délaisse la ligne mélodique et sentimentale du premier thème de Remington Steele, par exemple, pour privilégier l'action, en accentuant le dynamisme. Le montage du générique, succession rapide de plans de Washington (où se déroule l'action) et de scènes extraites des épisodes, se veut lui aussi d'une vivacité à l'image des scénarii.

FICHE TECHNIQUE
Créée par : Eugene Ross-Leming et Brad Buchner
Produite par : Juanita Bartlett
Co-producteur : Wayne Wahrman
Producteurs : Steve Hattman, Peter Lefcourt, Mark Lisson, Michael J. Maschio, Bill McCutchen, Bill Froehlich, Kurt P. Galvao, Ronald G. Smith, Dennis C. Duckwall, Eugenie Ross-Leming
Producteurs exécutifs : Brad Buckner, Tom Chehak, Rob Gilmer, Peter Rosten
Producteurs associés : Dennis C. Duckwall, George Geiger, Christopher Nelson, Sascha Schneider, Paul Waigner
Supervision de la production : Cliff Gould, Michael S. McLean Christopher Nelson
Consultants aux scenarii : Joel Steiger, David Brown, Pamela Chais, Rudolph Borchert
Musique : Mark Hoder, Arthur B. Rubinstein
Directeurs de la photographie : Edward R. Brown, Richard L. Rawlings, Michael W. Watkins, Eddie Rio Rotunno, Michael D. Margulies
Direction artistique : Patricia Van Ryker, Robert J. Bacon, Frederick P. Hope, John V. Cartwright, Jack G. Taylor Jr.
Décors : Leslie McCarthy-Frankenheimer, Robert Checchi, Deborah Siegel, Jerry Adams, W. Joe Kroesser, Jorg Neumann, Leigh Malone, Leonard A. Mazzola, Martin Price, Lee Poll, Gary Moreno
Distribution artistique : Eileen Mack Knight, Jean Sarah Frost, Dianne Young, Kathleen Letterie, Phyllis Huffman
Costumes hommes : Darryl Levine, Lola Bullion Chambers, James Lapidus, Richard Butz, Cliff Langer, Dawn J. Jackson, Karl-Heinz Stempel, Brian Cox, Dallas D. Dornan, Lawrence Richter
Costumes femmes : Andrea E. Weaver, Cynthia Helene, Molly Harris Campbell, Mari Grimaud, Libby Charlton, Joan Joseff, Emma Trenchard, Aida Swinson, Mary Gibson, Pamela Wise, Tina Joseff
Maquillage : Fred C. Blau Jr., Edwin Butterworth, Timothy A. Miguel
Coiffures : Susan Germaine, Chris McBee, Faith Vecchio, Cheri Ruff, Barbara Lorenz, Bette Iverson, Carol Meikle
Responsables de l'équipe de production : Edward Joseph, Bob Mendelsohn (Londres), Donald Roberts, Ronald G. Smith, Gerhard von Halem (Allemagne)
Premiers assistants-réalisateurs : Greg Beaudine, Michael Boyadjiew, Richard Butler, Tom Connors, Kevin Corcoran, James Dillon, Patrick A. Duffy, Daniel Dugan, Bettina Förg, Ryan Gordon, Paul Ivers, Ray Marsh, Don-Martin Nielsen, John Slosser, Michael Smid, Bruce Solow, Bill Westley
Réalisateur de la seconde équipe : Peter Carpenter
Efftets spéciaux : Bill Doane, Don Power, Arthur Sears, Eddie Surkin, Frank Toro, Harrie Wiessenhaan
Coordination des cascades : Richard E. Butler
Cascadeurs : Tom Morga, Donna Garrett, Steve Kelso, Bob Herron, Roydon Clark, Whitey Hughes, Jesse Wayne, Kenny Bates, Lane Leavitt, Michael M. Vendrell, Dick Warlock, James Winburn, Gary Davis, Brian J. Williams, Fred Lerner, Bob McGovern, Allan Graf, Dennis Scott, Dan Plum, Bruce Paul Barbour, Charlie Picerni, David LeBell, Larry Holt, George P. Wilbur, Erik Cord, Walter Gotell, Carl Ciarfalio, Jamie Namson, David M. Graves, Fred Waugh, Michael Adams, Gregory J. Barnett, David S. Cass Sr., Carol Daniels, Gardner Doolittle, Dick Durock, Jon H. Epstein, Dean Raphael Ferrandini, Chuck Hayward, Hubie Kerns Jr., Dennis Lehane, Tony Snegoff, Jophery C. Brown, Ann Chatterton, Justin De Rosa, Dorothy Ford, Sandra Lee Gimpel, Randy Hall, Buddy Joe Hooker, Tommy J. Huff, Steven Lambert, Victor Paul, Jerry Brutsche, Michael Cassidy, Christopher Doyle, Louie Elias, Dana Dru Evenson, Marneen Fields, Ted Grossman, Orwin C. Harvey, William T. Lane, Beth Nufer, Wally Rose, Peter Stader, Jack Verbois, Nick Dimitri, Debbie Evans, Marian Green, Terry Jackson, Joel Kramer, Carey Loftin, David Zellitti
Seconds assistant-réalisateurs : Bill Carroll, Jan DeWitt, Robert J. Doherty, W. Alexander Ellis, Stephen J. Fisher, Robin Holding, Richard Hoult, Stewart Lyons, Victoria E. Rhodes, Donald Roberts, Ronald G. Smith, Steve Stafford, Lewis Stout, Paul Tivers, Steven Tramz
Responsables de plateau : Ed Brown, Peter Leier, Jimmy Lodge, Douglas Middleton
Coordination de la construction : Beverly Hadley
Montage du son : Sam Caylor, Don Crosby, Robert Heffernan, Heiko Hinderks, Sid Lubow, Eugene Marks, Allan R. Potter, Don Rush, Corinne Sessarego, George Stephenson
Montage de la musique : Don H. Matthews, James Troutman, Josef Von Stroheim
Responsable du mixage : Allan R. Potter, Abby Treloggen
Supervision du montage : Erwin Dumbrille
Montage : Dennis Orcutt, George J. Kramer, Ronald LaVine, Bill Brame, Wayne Wahrman, Ron Sprang, Christopher Nelson, Robert Watts, Ann E. Mills
Production : Shoot the Moon Enterprises et Warner Bros Television (1983/1987)