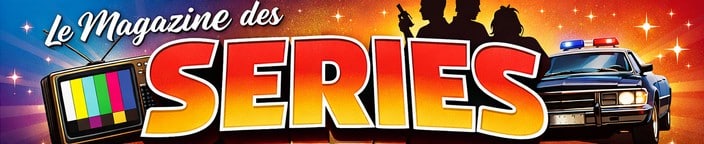Par Thierry Le Peut
Lorsque l’agent 86 cessa ses activités dans la série "Max la menace" pour s’occuper de ses jumeaux, en 1970, après avoir passé la bague au doigt de l’agent 99, l’espionnite était en voie de rémission. Mais elle avait atteint en quelque sorte son apogée en 1966. Notamment avec la série que beaucoup considèrent, encore aujourd’hui, comme l’archétype de la série d’espionnage. "Mission : Impossible". Cette dernière mettant notamment en vedette l'agent secret Jim Phelps. Créée par Bruce Geller, la série allie un grand sens du réalisme, au moins émotionnel, et une écriture rigoureuse qui font de chaque épisode une mécanique bien huilée.

Présentation du concept
La série présente les missions très secrètes menées par un groupe d’agents pour le compte du Département d’Etat américain, en toute illégalité. Comme "Destination Danger" et "Des Agents Très Spéciaux", le programme s’inscrit dans la lutte Est-Ouest et prend la défense des démocraties occidentales contre le danger totalitaire, qu’il vienne des pays de l’Est, de l’Amérique du Sud ou de l’Afrique. Les agents de l’Impossible Missions Force sont ainsi des hommes et des femmes doués de talents particuliers enrôlés pour leur aptitude à se sortir de toutes les situations et leur grande capacité de comédiens, qui est mise en avant dans tous les épisodes.
Si les gadgets et les astuces jouent un grand rôle dans les missions, ce sont pourtant les personnages qui occupent le devant de la scène. Le gadget en effet crée les conditions de la réussite de chaque mission, mais c’est avant tout par leur talent d’acteurs et de metteurs en scène que les agents mènent à bien leurs opérations. Celles-ci les conduisent en de nombreux points du globe mais l’exotisme n’est pas la carte maîtresse du show, qui se focalise sur le déroulement d’une savante machination fondée sur la dissimulation et l’illusion, et sur le comportement des agents à chaque étape de la mission, en particulier face au risque constant de dérapage.
Jeu d'échec
Mieux qu’aucune autre, "Mission : Impossible" parvient à mettre l’accent sur le danger que représente la vie d’agent secret, mais un danger de chaque instant qui réside non dans une arme braquée sur vous mais dans un mot, un pas de travers, une simple erreur. A l’action échevelée et aux fusillades entre camps adverses, Bruce Geller répond par l’intelligence et la préméditation : les agents de l’IMF, Jim Phelps en tête, ne mènent pas d’enquête, ils ne traquent personne et ne font que rarement le coup de poing.
Lorsqu’ils entrent en scène, ils ont déjà en main tous les éléments nécessaires à la compréhension de leur mission, qui prend invariablement la même forme: il s’agit de tromper quelqu’un, d’endormir sa méfiance ou de le conduire dans un traquenard imparable afin de le neutraliser définitivement. L’espionnage, plus qu’un affrontement physique, est ici une partie d’échec, un jeu au sens théâtral du terme. Le microfilm, le renseignement ou l’objet que doivent récupérer ou détruire les agents n’est rien d’autre qu’un MacGuffin, un prétexte à un jeu du chat et de la souris où le méchant de la semaine est perdant d’avance.

Série au long cours
La série, commencée le 17 septembre 1966, durera huit saisons, soit plus que n’importe laquelle des autres séries citées ici. On situe cependant l’âge d’or de la série dans les deuxième et troisième saisons, celles où les scénarii et le jeu des acteurs apparaissent comme les plus rigoureux. Au-delà, la série reste de qualité mais tend parfois à se répéter et ne bénéficie plus de l’aura de deux acteurs de premier plan, Martin Landau et Barbara Bain, époux à la ville et couple culte à l’écran.
Inspirée à Bruce Geller par les films "Opération Topkapi" et "Du Rififi chez les Hommes", "Mission : Impossible" a fait de quelques scènes très simples de véritables morceaux d’anthologie. La plupart des épisodes s’ouvrent ainsi sur trois scènes immuables qui mettent en exergue la mécanique parfaitement huilée sur laquelle repose le succès de chaque mission.
Bonjour Monsieur Phelps
La scène du magnétophone, où Jim Phelps reçoit les informations nécessaires à la préparation de la mission, la scène du choix des agents et celle du briefing préliminaire sont les passages obligés d’un scénario classique de la série. La suite de l’épisode n’est que la mise en application d’un plan dont on ne connaît que les grandes lignes, de manière à laisser suffisamment de marge pour ménager quelques effets de surprise.
Le générique lui-même est un modèle du genre, tant par la musique de Lalo Schifrin, devenue un hit mondial, que par le montage très serré de plans brefs extraits de l’épisode à venir. Quelques secondes suffisent pour être emporté par un rythme dynamique, alors même que la série est plutôt avare en scènes d’action pure.
Un très grand merci à Régis Dolle, responsable de la page Facebook, A l'image des séries, pour les photos fournies et venant de sa collection.